Ce volume de plus de 700 pages décrit 453 produits, de l’Alpenbitter aux rissoles au sérac. Mais que mettre en avant, dans cette profusion? demandons-nous à son auteur. Paul Imhof cite la «chèvre», un «champagne paysan» de Suisse romande, qui a été pour lui «une véritable découverte». Existant depuis au moins trois générations, cette boisson est encore fabriquée aujourd’hui par certains vignerons pendant les vendanges, surtout dans la campagne genevoise. Paul Imhof a rendu visite à l’un d’entre eux, qui lui a révélé sa recette à base de jus de raisin légèrement fermenté, de farine de riz, de sucre de raisin, d’eau de vie et de vanille.
Le mélange fermente au moins un mois dans un tonneau cerclé d’acier «pour éviter qu’il n’explose». Il est prêt pour la Saint-Sylvestre. Fraîchement tiré du tonneau, le vin blanc mousseux jaillit en chuintant du robinet presque comme du lait sortant du pis de la chèvre, d’où son nom. Une autre trouvaille de Paul Imhof est le «furmagin da cion», fabriqué dans le val Poschiavo, une vallée italophone du canton des Grisons. En dialecte local, «cion» signifie «cochon», et «furmagin», «petit fromage».
Toutefois, il ne s’agit pas d’un produit laitier, mais d’une tarte à la viande roborative. Jadis, chaque ferme préparait son propre «furmagin» au moment de l’abattage des porcs, à partir de restes de viande et d’abats. Manger l’animal «du museau à la queue» est à la mode aujourd’hui, mais à l’époque, c’était une évidence. Les boucheries du val Poschiavo fabriquent encore le «furmagin», mais «selon différentes recettes», explique Paul Imhof: «Il s’agit d’un ancien produit de la ‹cucina povera›, la cuisine des pauvres, qui est devenu une spécialité très prisée.»
En quête du passé
Pourquoi et comment faire des recherches sur le patrimoine culinaire d’un pays? Il y a 25 ans, c’est le conseiller national vaudois Josef Zisyadis, du parti du Travail, qui a lancé l’idée. «Par son initiative, il voulait éviter que les traditions culinaires suisses et le savoir-faire qui les accompagne ne sombrent dans l’oubli», relate Paul Imhof. Le Conseil fédéral et le Parlement l’ont suivi, et une équipe de spécialistes mandatée par la Confédération et les cantons s’est mise au travail. Elle a fouillé les bibliothèques et les archives, rendu visite aux producteurs et consigné des produits, des processus de fabrication, des recettes. Le résultat a paru en ligne en 2008 sur www.patrimoineculinaire.ch.
Paul Imhof, aujourd’hui âgé de 72 ans, a pris part au projet dès le début. Le journaliste a décidé de transformer le riche inventaire en ligne en un ouvrage agréable à lire. Cinq volumes sont parus jusqu’en 2016, et certains sont épuisés. Son dernier livre est une édition complète actualisée. Il y a intégré une catégorie de produits qui ont la particularité d’être disponibles depuis au moins 40 ans, comme le riz tessinois, un symbole du changement climatique. L’ouvrage est rédigé dans un style léger et instructif à la fois. Les produits présentés sont complétés par des faits historiques et des anecdotes que l’auteur a relevées durant ses recherches. Structuré par canton, ce livre invite à un voyage à travers le paysage culinaire de la Suisse, dont la diversité est le fruit de la rencontre entre différentes cultures. C’est pourquoi, dit Paul Imhof, il n’existe pas de plat national: «La cuisine suisse tire sa force de ses régions.»
La topographie, source d’idées
Le relief et l’espace limité du pays influencent cependant les ingrédients. Avant la correction des eaux, les terres arables étaient rares. La production animale, très répandue, a fait de la Suisse la «championne des conserves», note Paul Imhof: pour une plus longue conservation, le lait fut transformé en fromage, et la viande en saucisses et en viande séchée. Ainsi sont apparues des réserves qui pouvaient aussi s’échanger. Le Sbrinz, par exemple, «plus vieux fromage d’exportation suisse», a vite gagné les villes du Sud par les chemins muletiers, et le Schabziger glaronnais les marchés zurichois. «Un pays se définit aussi toujours par sa cuisine», indique Paul Imhof.
Pour lui, le patrimoine culinaire suisse est «un trésor foisonnant, qui dénote une grande inventivité». Recettes de pain d’épices vieilles de plusieurs siècles et birchermüesli bon pour la santé font partie de cet héritage, au même titre que des produits industriels plus récents, par exemple le célèbre condiment jaune «Aromat» et la boisson au petit-lait «Rivella». À l’ère des plats cuisinés, des additifs et des mises en scène culinaires sur les réseaux sociaux, Paul Imhof trouve qu’il est «plus important que jamais» de connaître ses origines. Et les services rendus par celles «qui ont cultivé le terrain de la gastronomie: les paysannes, les domestiques et, plus tard, les cuisinières».
Il souligne aussi la créativité des bouchers, qui, au fil des siècles, ont inventé plus de 400 sortes de saucisses, dont seule une fraction est présentée dans le livre. Leurs produits traditionnels continuent de mettre en valeur le travail des «artisans du bon manger», relève Paul Imhof. Qui attribue, du reste, le succès du cervelas au canton de Soleure. Non que ce saucisson cuit et fumé y ait été inventé, mais parce que la ville centrale d’Olten a fortement contribué à sa popularité jusque dans les années 1980: la salade de cervelas du buffet de la gare, dont se régalaient après leurs réunions les associations, partis, syndicats et clubs, est devenue célèbre dans tout le pays.
Vin du glacier
À l’entrée «Vin du glacier», l’encyclopédie donne un aperçu de l’ancienne agriculture itinérante des vallées latérales valaisannes. Au XVIIIe siècle, des paysans plantèrent des vignes dans la vallée du Rhône, alors marécageuse, pressèrent les raisins et acheminèrent le vin dans leurs villages d’altitude. Là, au frais, par exemple à côté du glacier de Moiry, au-dessus de Grimentz, ils le conservaient pendant des années dans les tonneaux de la commune ou des familles, sans qu’il se gâte. Année après année, on remplissait les tonneaux. La bourgeoisie de Grimentz en possède encore plusieurs. «Le plus ancien, le tonneau de l’Évêque (1886), a reçu en 2022 un assemblage de plus de 130 millésimes», relate Paul Imhof. Qui a pu goûter le vin du glacier, et confie que celui-ci a un goût de sherry.
Dans les années 1980 et 1990, Paul Imhof a lui-même vécu à l’étranger, quand il était correspondant de la «Basler Zeitung» en Asie du Sud-Est. À Singapour, il a vu des chefs suisses faire de la cuisine suisse dans les hôtels et se faire livrer de la crème ou du chocolat, par exemple. «Les Suisses de l’étranger contribuent à la préservation du patrimoine culinaire», déclare-t-il. Dernière question à l’auteur: sachant que les clubs suisses du monde entier se réunissent régulièrement autour d’une fondue, peut-on vraiment affirmer qu’il n’existe-t-il pas de plat national? Si l’on tient absolument à en définir un, ce serait effectivement la fondue, répond Paul Imhof. La diversité fromagère est caractéristique de la Suisse, et ce que l’on a mangé dans son enfance façonne le palais pour toute la vie.

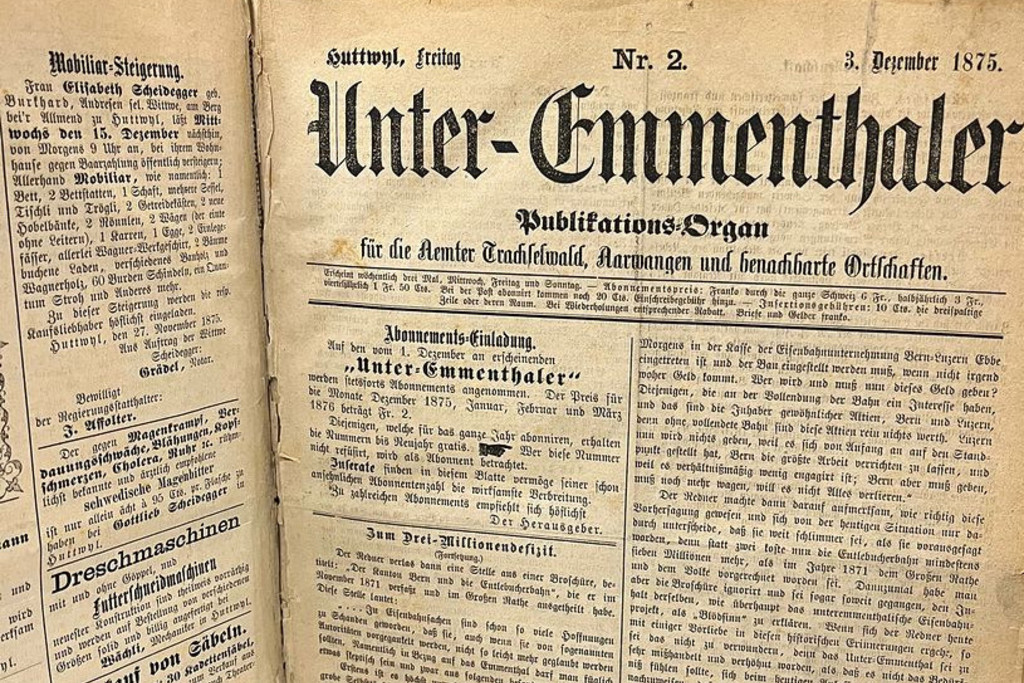












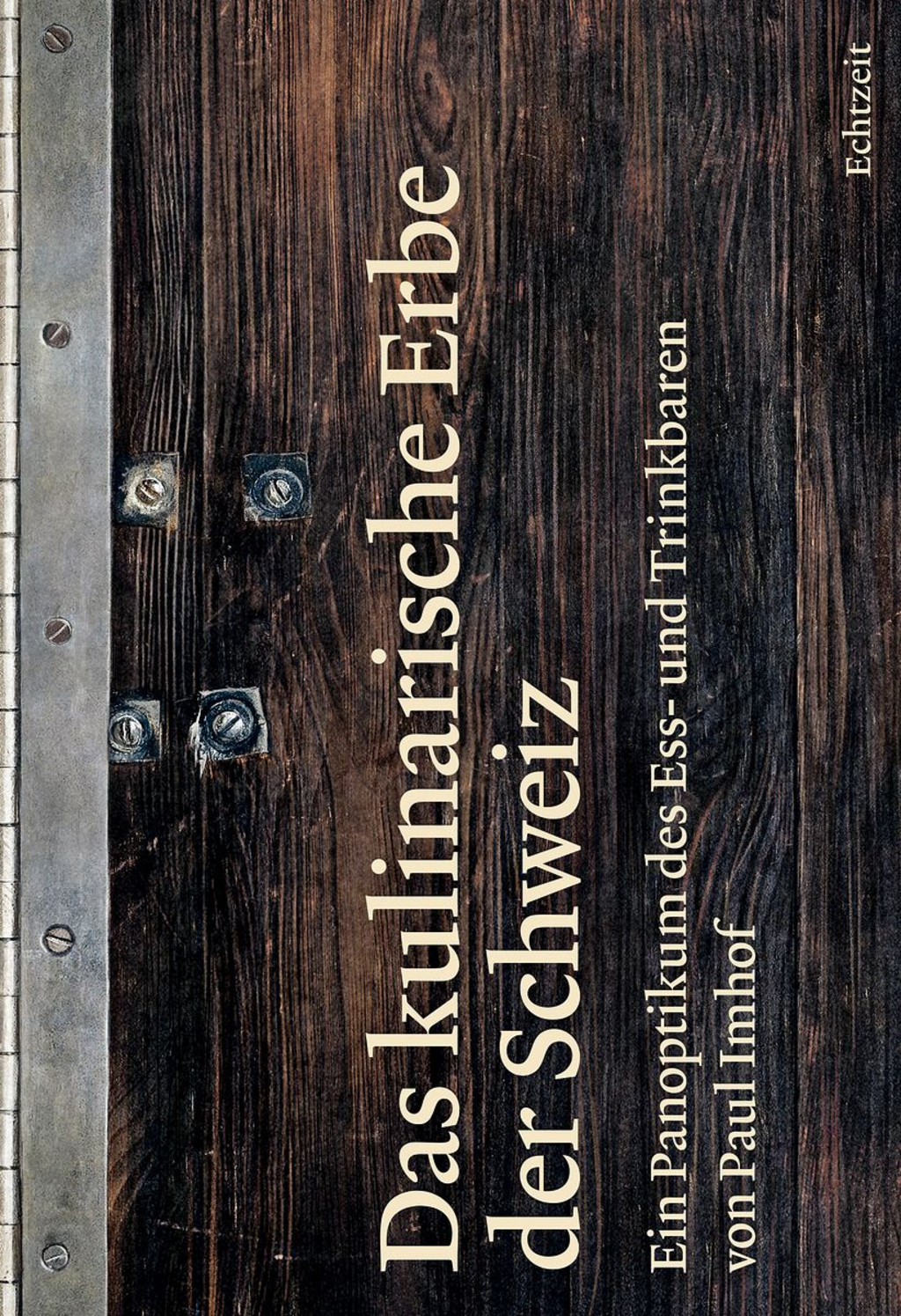


Commentaires