Monsieur Osterwalder, le cinquantenaire de 68 est une évènement majeur de l’année. Et pour vous, il s’agit d’un chapitre de votre biographie personnelle. Quel effet cela fait-il d’observer sa propre jeunesse dans un musée?
On remarque qu’une chose à laquelle on a participé est désormais terminée. Dans le même temps, on tire le bilan des évènements.
Quel est-il?
Il y a deux aspects. Nous avions des préoccupations: l’équité sociale, l’égalité des sexes, l’ouverture de la société. De ce point de vue, il y a eu des progrès importants, notre engagement a été utile. D’autre part, nous souhaitions révolutionner entièrement la société, avec des théories du 19e siècle, marxistes, socialistes, trotskistes, etc. Cela n’a rien donné, et tant mieux pour nous.
Pourquoi «tant mieux»?
En Suisse, nos idées n’ont pas eu beaucoup d’impact. Dans de nombreux pays d’Amérique latine en revanche, les révolutions marxistes se sont quelquefois terminées de manière affreuse. Elles ont coûté des vies, et également celles de marxistes. Ainsi, en Europe, nous avons vécu les évènements de 68 de manière privilégiée.
Parce que personne n’a dû assumer le rêve de révolution?
Plus encore, des personnes comme moi ont même pu faire carrière au sein du système d’éducation nationale en devenant professeur.
Ce même système que vous souhaitiez renverser lorsque vous étiez marxiste.
Exactement. Nos idées, basées sur une démocratie des conseils ou encore l’économie planifiée, étaient aussi fondamentalistes que rudimentaires, voire naïves. Cela aurait pu mal tourner. Très mal.
C’est-à-dire de manière antidémocratique?
Antidémocratique. Totalitaire. Chaotique.
En 1968, vous aviez seulement 21 ans. Ensuite, vous avez apporté votre aide lors de la création de la section zurichoise de la LMR, la «Ligue marxiste révolutionnaire», issue d’une scission au sein du Parti ouvrier populaire.
Oui, mais c’était seulement en 1971. En 68, c’était différent: un mouvement large, très varié, d’anticonformistes, c’est-à-dire de personnes qui n’étaient pas satisfaites de l’ordre social en place, ont articulé cette insatisfaction en dehors des structures politiques traditionnelles, et donc également en dehors des vieux partis de gauche. Tout ce mouvement allait bien au-delà d’un certain milieu social. Ces anticonformistes regroupaient aussi des personnes qui souhaitaient un changement dans la littérature ou le théâtre. D’autres aspiraient à une ouverture du système éducatif. Et d’autres enfin étaient totalement apolitiques.
Et comment ces personnes se sont-elles organisées à l’époque?
On se rencontrait lors des manifestations, dans des bistrots et dans des groupes d’action qui poursuivaient certains objectifs, comme par exemple la solidarité avec le Vietnam, une participation active aux syndicats ou bien le renouvellement du théâtre. Les groupements politiques n’étaient pas encore très structurés. Chez nous, en Thurgovie, un cercle d’étudiants, d’élèves et d’apprentis mais aussi de représentants de la «vieille gauche» se réunissaient pour discuter.
«1968» était donc plus qu’un simple mouvement étudiant
J’étais étudiant, et nous nous engagions pour les réformes étudiantes mais aussi pour les apprentis ou les travailleurs étrangers en Suisse. Aujourd’hui, on a du mal à imaginer, mais à l’époque, à l’extérieur de Frauenfeld, il y avait une décharge et, à côté, des baraquements où habitaient les travailleurs immigrés d’Italie, séparés de leurs familles qui ne pouvaient pas les rejoindre dans notre pays. Voilà comment la Suisse les traitait. Nous souhaitions faire quelque chose contre cela.
Le sentiment de pouvoir changer le monde semblait unir le mouvement, au-delà de toutes les différences.
Oui, nous avions ce sentiment: maintenant, nous allons tout renouveler, et tout rendre meilleur, surtout d’un point de vue moral. La morale était très présente en 1968. De petits noyaux du mouvement étaient issus du PS ou du Parti du travail. Mais une grande partie émanait de cercles religieux. Plus de solidarité et de justice pour le tiers monde, pour les travailleurs immigrés, pour les femmes: tout cela se basait sur des fondements moraux très forts.
Et quel a été le rôle des protestations contre la guerre du Vietnam?
Cette guerre a politisé beaucoup de personnes, tout comme la révolution socialiste à Cuba, le combat de libération de l’Algérie occupée par la France, mais également les mouvements dissidents au sein du bloc de l’Est. Ces évènements nous ont fait découvrir la résistance émergente face à «l’impérialisme» et les régimes d’Europe de l’Est. Et nous nous considérions comme une composante de cette résistance.
C’est également comme cela que les représentants de l’ordre établi vous percevaient: les autorités ont réagi aux protestations par la répression.
Oui, c’était l’époque de la Guerre froide, du fichage et des indicateurs. Mais pas seulement. Nous étions aussi disposés à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos exigences et cette propension touchait également le milieu des élites traditionnelles.
Vraiment?
Certaines universités faisaient preuve d’une grande ouverture. Les directions et de nombreux professeurs voulaient débattre avec vous. Plus tard, j’ai vécu la même chose en tant que professeur. J’enseignais dans une école professionnelle zurichoise pour les personnes sourdes, notre directeur d’école était le président d’une section locale de l’UCD et malgré tout, nous nous réunissions une fois par semaine afin de discuter.
Vous avez été interdit d’exercer votre profession...
Pas ça, non. Je n’ai pas été désigné professeur principal dans un lycée de Winterthour et j’ai perdu mon poste pour des raisons politiques, mais j’avais le droit d’enseigner dans d’autres écoles publiques.
En 1979, dans un livre, vous expliquiez la «voie vers le socialisme en Suisse»: il s’agissait «de renverser le capitalisme, de briser le pouvoir de la classe capitaliste de disposer de la grande majorité de la population».
C’est comme cela que nous le formulions à l’époque. Nous voulions abolir la société bourgeoise, la propriété privée des moyens de production, nous voulions une société égalitaire, non seulement d’un point de vue juridique, mais aussi social.
Les gens de gauche comme vous ont raté l’occasion d’analyser leur passé de façon critique, a affirmé la Weltwoche dans un article à l’occasion du dernier anniversaire de 68, il y a dix ans.
Comme je l’ai déjà dit, je suis content que cette révolution n’ait pas eu lieu. Dans le même temps, je suis heureux que beaucoup de nos exigences aient été concrétisées. Ainsi, de nos jours, il y a plus d’égalité entre les sexes, la situation des travailleurs étrangers en Suisse s’est améliorée, la retraite est garantie pour tous.
Et le capitalisme?
Certaines de nos idées sont toujours actuelles. Par exemple le poids des capitaux bancaires opérant à un niveau global, qui a plongé le monde occidental dans la crise en 2008. Aujourd’hui encore, il serait intéressant pour notre société de contrôler ce pouvoir démocratiquement.
Vous étiez un pédagogue et un professeur de pédagogie: quelles ont été les conséquences de 68 sur l’école?
D’une part, le système éducatif a été ouvert. Nous avions 36 élèves dans notre classe du lycée de Frauenfeld, dont seulement cinq filles. Aujourd’hui, il y a plus de filles et plus d’enfants des classes sociales inférieures dans les écoles supérieures. De plus, les châtiments corporels ont disparu, mais pas l’autorité, heureusement.
Est-ce qu’aujourd’hui vous êtes un libéral?
Oui, je dirais cela: social-libéral. Le libéralisme bourgeois était l’un des ennemis de 68, mais de nos jours, il constitue le fondement d’une société démocratique. On le voit dans la Russie actuelle: une démocratie devient autoritaire lorsqu’il n’y a pas de libéralisme.
Les soixante-huitards ont grandi dans la société de prospérité et de croissance de la période d’après-guerre. Ils ont ensuite déclaré la guerre à cette société et à ses valeurs. Est-ce que ce n’est pas paradoxal?
Non, c’est même plutôt logique. Lorsque l’on doit se battre pour son existence, on ne passe pas prioritairement son temps à élaborer des modèles alternatifs, comme nous à l’époque. Et à l’inverse, lorsque l’on peut boire sa bière et manger son filet de viande, on peut malgré tout réfléchir. Par exemple au fait que cette aisance n’existe pas dans le tiers-monde. De telles différences peuvent particulièrement éveiller les consciences en ce qui concerne les questions de justice sociale.
À partir de 1980, votre LMR s’est appelée Parti socialiste ouvrier. Il a obtenu quelques sièges dans des cantons et communes et a également lancé une initiative fédérale pour la formation professionnelle garantie, clairement rejetée en 1986. En 1987, le Parti socialiste ouvrier a stoppé ses activités, de nombreux membres ont rejoint les Verts ou le PS.
Oui, pour ma part, j’en ai fait partie jusqu’au bout, mais je n’ai ensuite rejoint aucun parti, parce que mes travaux scientifiques m’intéressaient davantage. Cependant, je me sens toujours engagé par rapport à nombre de nos revendications.
Lesquelles?
La démocratisation, en particulier pour de nombreuses questions économiques, l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ou bien la sécurité sociale.
Daniel De Falco est journaliste au journal «Der Bund» et historien
Fritz Osterwalder
Fritz Osterwalder, né en 1947 à Frauenfeld, étudiait en 1968 l’histoire et la littérature allemande à Zurich. Aujourd’hui, il est surtout connu pour ses recherches sur les relations entre les idées pédagogiques, la religion et l’État. Il s’est fait connaître en particulier en raison de son regard critique sur les «attentes de salut» que la société adresse à l’école, et sur le «culte» relatif aux réformateurs de la pédagogie tels que Montessori, Steiner ou Pestalozzi. En 2012, Osterwalder a pris sa retraite à l’Institut des sciences de l’éducation de l’Université de Berne où il travaillait depuis 2000. Auparavant, il a enseigné la pédagogie à Karlsruhe et a été enseignant ainsi que journaliste à Zurich et Winterthour.
1968: Plus qu’une simple agitation et des scandales
1968? De nos jours, les historiens évoquent plutôt les «années 68» pour indiquer que les évènements, également en Suisse, ne se sont pas limités à une année. Il y a eu l’agitation lors du concert des Rolling Stones au Hallenstadion de Zurich en avril 1967, l’occupation d’un séminaire de professeurs à Locarno en mars 1968, les combats de rue de Zurich de juin 1968, appelés l’émeute du Globus, la grande démonstration féminine sur la place Fédérale («la marche sur Berne») en mars 1969 ou l’exposition provocante d’Harald Szeemann «When Attitude Becomes Form» à la Kunsthalle de Berne en mars/avril 1969. Le mouvement des années 68 était une révolte contre l’autorité traditionnelle et exigeait l’autodétermination, la justice et la solidarité. Dans le même temps, une évolution plus globale est devenue visible dans les protestations médiatisées: celles-ci constituaient le point d’orgue d’un renouveau social qui avait déjà débuté en 1965 et qui a duré une bonne décennie. Ce renouveau s’est caractérisé par exemple par le nombre croissant de divorces, de diplômés des hautes écoles ou de femmes sur le marché du travail. D’autre part, la prospérité, la culture de la jeunesse et les médias de masse ont également créé une dynamique s’opposant de plus en plus aux valeurs conservatrices qui ont façonné l’ère de l’après-guerre en Suisse. Cela a entraîné une modernisation sociale éclatant au grand jour lors des protestations de 1968 et aboutissant finalement à des réformes politiques, mais aussi à une large libéralisation des normes sociales: du concubinage à la culture de consommation, en passant par les coupes de cheveux, les modes de vie acceptés sont devenus plus diversifiés. Ainsi, de nombreuses choses aujourd’hui évidentes découlent de ces «années 68».

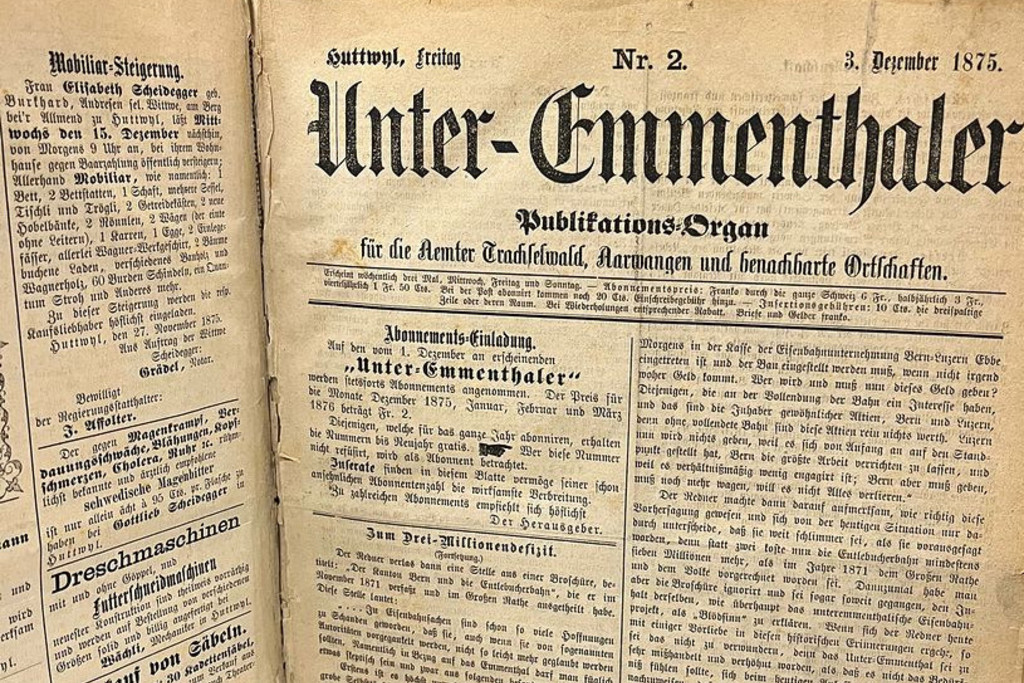












Commentaires
Commentaires :
Curieuse - et bien pauvre - argumentation a contrario qui consiste à justifier en une seule ligne le bien fondé du libéralisme avec l'affirmation (simpliste et manichéiste) que l'anti-libéralisme n'est pas démocratique, sans apporter une quelconque autre explication. L'exemple est celui de la Russie, bien entendu, pour rester dans le conformisme bien douillet de la bonne presse occidentale.
Désolé M. Osterwalder, vous êtes resté COMPLETEMENT marxiste dans votre dialectique.
Je vous signale au passage que la Russie vient de se sortir brillamment d'une période de massacres, de terreur et de persécutions sur 70 ans (!!!). Sur ce plan-là elle n'a de leçons à recevoir de personne en économie, surtout quand elle réussit encore à trouver de bonnes solutions pour contrer des sanctions économiques stupides, qui ont pénalisé par ailleurs bien plus qu'on croit de corporations et entreprises occidentales, demandez donc aux agriculteurs français ce qu'ils en pensent.
" je n’ai ensuite rejoint aucun parti, parce que mes travaux scientifiques m’intéressaient davantage"
Courageux ... mais pas téméraire, quand il s'agit de préserver vos intérêts personnels.
Cordialement,
DP
One of the foremost democracies left!
Beste Grüsse,
Gogo 1968